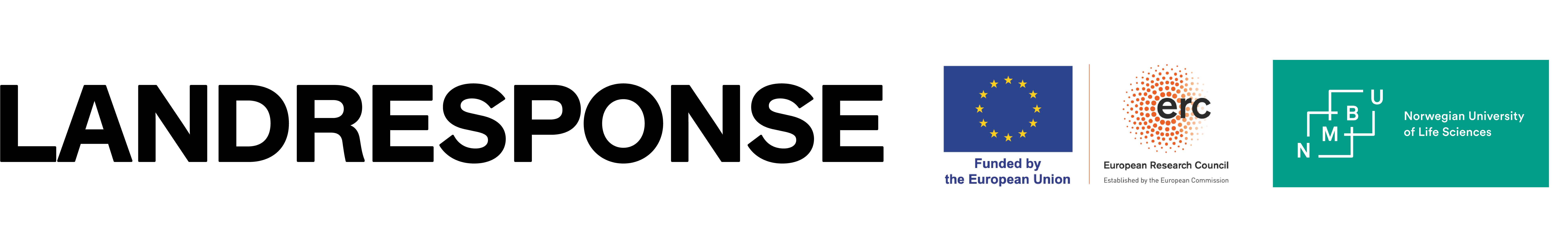

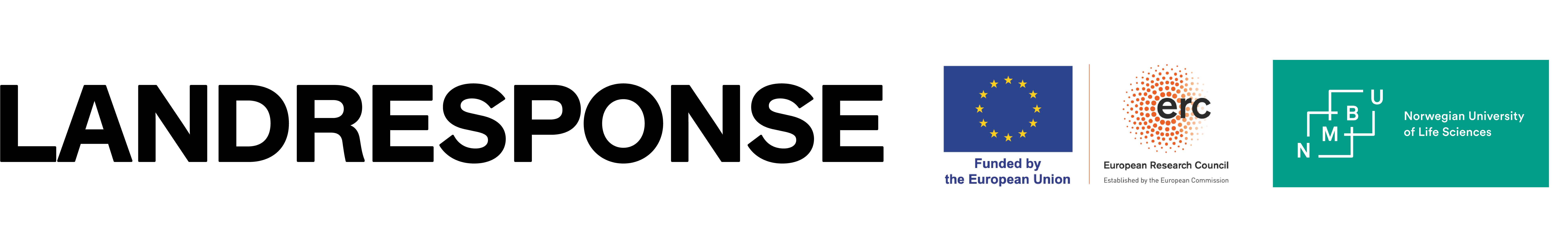
Par T. A. Benjaminsen (2025)
Article journal dans Nytt Norsk Tidsskrift, Oslo

Dans Nytt Norsk Tidsskrift no. 4/2023, j'ai critiqué le non-anthropocentrisme qui pose des problèmes éthiques en ignorant des questions telles que le pouvoir, les droits de l'homme et la distribution (Benjaminsen, 2023). Appliqué comme point de départ éthique dans le Sud global, le non-anthropocentrisme sape également la cause climatique et environnementale en s'opposant à la justice climatique et environnementale. Pour étayer cette critique, j'ai donné plusieurs exemples d'initiatives d'élevage de rennes samis et de conservation de la nature dans le Sud. Dans Nytt Norsk Tidsskrift no. 2/2024, j'ai reçu des réponses des philosophes Arne Johan Vetlesen (2024) et Sigurd Hverven (2024). Tous deux sont d'accord avec ma critique de la version ANT du non-anthropocentrisme et estiment qu'il devrait y avoir une distinction analytique entre la société et la nature. Hverven dit même que j'ai quelques points intéressants et bons qui donnent à réfléchir et qui devraient être pris au sérieux.
Par I. Poudiougou (2025)
Article journal dans Cahiers d’Études africaines, Paris

L’insurrection djihadiste armée dans le centre du Mali a donné lieu à une contre-insurrection des groupes d’autodéfense comme celle portée par Dan Nan Ambassagou. Combattants djihadistes ou d’autodéfense, ces hommes en armes issus des couches sociales subalternes semblent faire de l’AK-47 l’instrument d’émancipation par excellence. Leur quête d’émancipation des dominations enracinées dans les structures sociopolitiques et historiques locales emprunte différents itinéraires selon que l’on se réclame du djihad ou de l’autodéfense. Cet article avance que la violence armée redessine les relations sociales internes aux sociétés peules et dogons du centre du Mali. La contestation des dominations s’alimente de la dénonciation des connivences entre des élites politico-traditionnelles peules et des fonctionnaires d’une part, et la mise cause des pratiques de capture de rentes par les élites scolarisées dogons urbanisées d’autre part. À partir de données ethnographiques, l’article illustre comment une telle quête mobilise différents registres de légitimation de la violence tels que l’appel au djihad, la résistance contre une « nouvelle mise en esclavage » et les accusations réciproques de dépossession des Dogons et des Peuls de leurs terres.
Par T. A. Benjaminsen (2024)
Livre publié par Edward Elgar Publishing, Cheltenham

Ma première visite au Mali a eu lieu pendant la saison sèche et chaude de 1987. C'était aussi mon premier travail de terrain et ma première visite en Afrique au sud du Sahara. L'objectif était de collecter des données pour un projet de recherche Cand. Scient. en écologie du paysage et géographie des ressources à l'université d'Oslo. Ce travail de terrain a eu lieu juste après la grande sécheresse sahélienne de 1984-85 et l'attention médiatique mondiale qui s'en est suivie. C'est également à cette époque qu'est né un nouveau concept, le « développement durable », qui représentait un regain d'intérêt pour l'environnement en pleine ère néolibérale. Les réponses aux problèmes environnementaux mondiaux étaient considérées comme une croissance économique accrue, non seulement dans les pays pauvres, mais aussi dans les pays riches - un paradigme dominant qui s'est maintenu jusqu'à aujourd'hui, mais plus récemment sous les appellations « croissance verte » ou « écomodernisme » dans le contexte de la transformation vers des sociétés à faible émission de carbone. Ce livre s'appuie sur 37 années de visites de recherche récurrentes au Mali et trace les lignes et les connexions entre les différents thèmes sur lesquels j'ai travaillé au fil des ans - désertification, pastoralisme, conflits d'utilisation des terres, rébellions touarègues et djihadistes. L'un de mes principaux objectifs a été de discuter du contexte de la crise sahélienne actuelle. Je soutiens que la compréhension de cette crise nécessite une approche d'écologie politique qui combine des perspectives historiques et matérialistes en se concentrant sur le contexte des motivations et de l'action des populations. Je soutiens également que le « développement durable » constitue la toile de fond des rébellions djihadistes actuelles au Sahel.
Book launch: Climate Security and Climate Justice in the Sahel - YouTube
Par I. Poudiougou (2024)
Article journal dans Revue Internationale des Études du Développement

Le 8 juin 2022, à 4 heures du matin, un groupe de 350 djihadistes a encerclé Makou, un village de la région de Bandiagara. Leur chef a forcé les habitants à partir. Les 422 ménages de Makou sont dispersés dans les villages voisins. Cet article analyse comment l'émergence de groupes armés normalise la violence et redessine les relations sociopolitiques dans les " terroirs historiques " du centre du Mali. Il examine comment Dan Nan Ambassagou combine la résistance armée contre les groupes djihadistes et la vie paysanne dans la région de Bandiagara.
Par T. A. Benjaminsen and B. Ba (2024)
Article journal dans Political Geography

Dans cet article, nous cherchons à comprendre les processus à l'origine du récent soulèvement djihadiste contre l'État au Mali. Nous utilisons le prisme analytique de "l'économie morale " pour observer les valeurs et l'éthique en jeu chez les individus qui ont décidé de rejoindre la rébellion djihadiste. Nous combinons cette optique avec une approche d'écologie politique qui renvoie aux racines du domaine à l'interface avec les études paysannes, en mettant l'accent sur l'économie morale et la dépossession des terres. Les processus généralisés de dépossession dans le centre et le nord du Mali ont créé une colère économique morale contre les élites à la recherche de rentes qui a servi de base au soulèvement djihadiste. Pour faire exploser cette colère, deux chefs djihadistes, Iyad Ag Ghaly et Hamadoun Koufa, ont joué un rôle clé en mobilisant le soutien populaire issu des griefs locaux, tout en s'appuyant sur un discours islamique basé sur la justice sociale et en capitalisant sur le soutien extérieur. Les griefs économiques moraux des Touaregs et des Peuls ont des origines différentes, bien que pour les deux groupes la défense du pastoralisme soit au cœur du problème. Lorsque le soulèvement est devenu "djihadiste" à partir de 2012, et que les Peuls ont commencé à le rejoindre, il est devenu également attrayant pour les classes subalternes qui ont vu dans la rébellion une occasion de libération sociale. Les références fréquentes à l'Empire Macina du 19ème siècle comme la période dorée du pouvoir pastoral peul ont également joué un rôle clé dans l'émergence d'un récit sur la résistance pastorale à un État dominé par les Bambaras.
Par H. Svarstad et T. A. Benjaminsen (2024)
Chapitre du livre dans Elgar Encyclopedia of Environmental Sociology

L'écologie politique (EP) est un domaine critique et interdisciplinaire dans lequel les changements environnementaux et les luttes sont étudiés tels qu'ils se déroulent dans et à travers des cas du Sud et du Nord. Ces études combinent généralement des analyses des dimensions matérielles et discursives, et se concentrent souvent sur le pouvoir, la marginalisation et les conflits liés à l'accumulation de capital, à l'injustice et aux pratiques néocoloniales. Le domaine est apparu dans les années 1980 et les politiques et la construction sociale des connaissances environnementales, combinées à des enquêtes empiriques, ont été parmi les principaux thèmes depuis le début. Bien que les sociologues ne dominent pas la communauté mondiale de l'EP, les théories centrales de la littérature sur l'EP sont enracinées dans la sociologie classique et, plus largement, dans la théorie critique des sciences sociales. Les études sur l'EP sont basées sur des combinaisons de diverses perspectives de pouvoir et en particulier la théorie wébérienne orientée vers l'acteur, les vues marxistes matérielles-économiques et structurelles sur le pouvoir, les idées discursives sur le pouvoir inspirées de Gramsci et la notion de gouvernementalité de Foucault.
Par I. Poudiougou (2023)
Article journal dans Anthropos

"Notre objectif est de créer un climat de paix et de liberté dans nos villes et nos villages. Cela va à l'encontre de la naissance d'un mouvement djihadiste qui prône l'obligation de respecter une autre forme d'islam. Nous disons non et nous voulons que nos parents qui résident dans nos villages aient la liberté de pratiquer, s'ils le souhaitent, la religion de leurs ancêtres." Le porte-parole de Dan Nan Ambassagou a fait cette déclaration aux médias en juillet 2017, commentant la création d'un mouvement d'autodéfense armé dirigé par Y. Toloba. L'analyse de cette mobilisation armée doit prendre en compte des facteurs tels que l'émancipation des cadets sociaux (Bayart 1979) par rapport aux élites établies, la violence pour les terres agricoles et pastorales, et la transformation progressive d'un "terroir historique" en une entité politique. Cet article décrit la mobilisation des mouvements armés d'autodéfense et l'insécurité dans le territoire Dogon au centre du Mali.
Par T. A. Benjaminsen (2023)
Article journal dans Nytt Norsk Tidsskrift

La signification pratique du non-anthropocentrisme n'est souvent pas claire. Lorsqu'une clarification est tentée, elle se révèle être une négligence eurocentrique des questions de pouvoir, de droits de l'homme et de distribution. Ainsi, le non-anthropocentrisme est en conflit direct avec la justice climatique et environnementale.
The Risks of Ecological Security
Par T. A. Benjaminsen (2023)
Article journal dans New Perspectives

Les études quantitatives sur la paix et les conflits (par exemple Buhaug 2010 ; Theisen et al., 2013 ; Koubi, 2019) et l'écologie politique basée sur des cas (par exemple Benjaminsen et al., 2012 ; Abrahams et Carr 2017 ; Benjaminsen et Ba, 2021) ont remis en question les hypothèses sur le changement climatique en tant que moteur de la violence et de l'insécurité, bien qu'il puisse y avoir des voies indirectes dans certains contextes. Ma propre position dans les débats sur la sécurité climatique et dans ces commentaires sur le livre discuté dans ce forum (McDonald, 2021) est enracinée dans mon expérience de la recherche en écologie politique sur les conflits d'utilisation des terres au Sahel, où j'ai vu la nécessité de repousser les récits simplistes et apolitiques qui donnent au climat un rôle de premier plan pour expliquer les crises et les conflits dans la région.
Conservation, dépossession des terres et résistance en Afrique
Par C. Cavanagh et T. A. Benjaminsen (2022)
Chapitre du livre dans The Oxford Handbook of Land Politics

LANDRESPONSE
is an NMBU project, funded by the European Research Council.
Address:
Postboks 5003
1433 Ås
Organization number: 969159570
Visitor addresses
Phone: 67 23 00 00
E-post